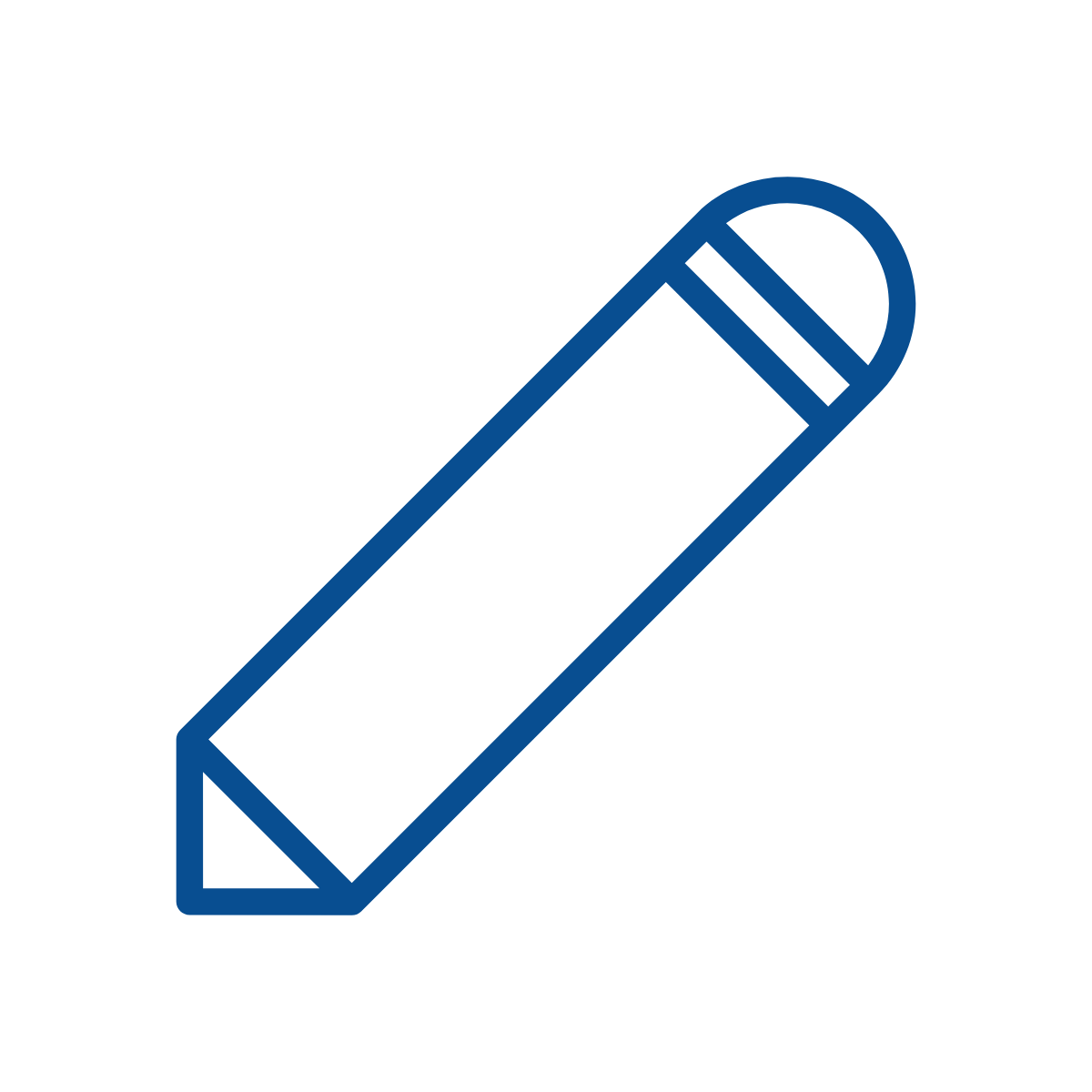Dans la même rubrique
-
Partager cette page
Beata OPACKA - Faculté des Sciences
Publié le 2 avril 2025
– Mis à jour le 2 avril 2025
Soutenance publique de thèse en vue de l'obtention du grade de Doctorat en Sciences
Titre de la thèse: Emission quantification of atmospheric tracers in the Tropics using satellite observations and inversion techniques
Résumé:
Dans une large mesure, la composition chimique de la troposphère est régie par les interactions entre la terre et l'atmosphère. En raison de leur grande réactivité et de leur omniprésence, les composés organiques volatils (COV) influencent fortement le pouvoir oxydant de l’atmosphérique, la formation de l’ozone troposphérique et de particules en suspension. Ils réagissent rapidement avec les radicaux hydroxyles (OH), le principal détergent atmosphérique, qui joue un rôle central dans la chimie de l'atmosphère. L'isoprène (C5H8) est le composé organique volatil biogénique (COVB) le plus abondant émis par la végétation terrestre, principalement par les arbres. Outre les importantes émissions dans certaines régions extra-tropicales telles que le sud-est des États-Unis, la majeure partie des émissions de COVB provient des écosystèmes tropicaux terrestres, en raison de la présence de forêts équatoriales denses ainsi que de conditions climatiques favorables. Toutefois, ces régions tropicales figurent parmi les environnements les moins étudiés et les plus incertains en termes d’émissions et de processus chimiques. En particulier, les faibles concentrations d’oxydes d’azote (NOX = NO + NO2) qui y prévalent modulent fortement les voies d’oxydation des COV. Les émissions naturelles de NOX , issues des processus microbiens du sol et de la foudre, représentent une source importante en Afrique et en Amérique du Sud, mais leur quantification reste associée à de fortes incertitudes. L’étude des COVB nécessite une approche interdisciplinaire combinant identification, quantification et compréhension de leurs sources, comportement et impacts atmosphériques. En chimie atmosphérique, la caractérisation des flux d’émission, de leur variabilité spatio-temporelle et de leurs impacts représente un défi majeur qui requiert une intégration de données satellitaires globales, complétées par des mesures in situ et de télédétection au sol, ainsi que l’usage de modèles numériques avancés incorporant les représentations les plus récentes des processus physico-chimiques, y compris les réactions photochimiques pertinentes. En particulier, les observations satellitaires du formaldéhyde (HCHO), un intermédiaire clé de l’oxydation de l’isoprène et d’autres COV, permettent d’inférer des informations précieuses sur les émissions de COVB lorsqu’elles sont couplées à des modèles de chimie-transport atmosphérique reliant les flux d’émission aux concentrations mesurées. Les modèles inverses, intégrant des algorithmes d’optimisation, visent à affiner l’estimation des émissions en exploitant les contraintes issues des observations satellitaires.
Cette thèse porte sur l’évaluation par modèle des émissions de gaz traces naturels, avec un accent particulier sur les émissions d’isoprène et de NOX naturelles, en s’appuyant sur l’exploitation de nombreuses données satellitaires, notamment les distributions de la couverture terrestre, l’humidité du sol, les densités de colonne de formaldéhyde, NO2 et d’isoprène, ainsi que les profils verticaux de NO2.
Le travail présenté ici se décline en : (i) une étude de l’impact de la distribution et de l’évolution de la couverture terrestre sur les estimations des émissions globales d’isoprène, incluant l’identification des principaux facteurs d’incertitude dans leur évaluation ; (ii) une étude des effets de la paramétrisation du stress hydrique sur les flux d’émission d’isoprène, appuyée sur des mesures uniques de flux réalisées lors d’épisodes de sécheresse dans le centre des États-Unis, avec une analyse des facteurs d’incertitude ; (iii) l’estimation et l’évaluation des émissions d’isoprène et de NOX obtenues via des inversions à deux espèces, exploitant les concentrations satellitaires de HCHO et de NO2 au-dessus de l’Afrique et de l’Amérique du Sud.
Cette étude contribue au développement d’un inventaire global et à long terme des émissions d’isoprène selon une approche ascendante (en anglais, bottom-up) intégrant les distributions de la végétation observées par satellite, ainsi qu’à l’élaboration d’inventaires descendants (en anglais top-down) des émissions naturelles d’isoprène et de NOX sur l’Afrique. L’étude d’inversion sur l’Afrique et l’Amérique du Sud repose sur le modèle de chimie-transport (CTM) MAGRITTE et son module d’inversion, développés et adaptés aux inversions à deux espèces par l’équipe de modélisation troposphérique de l’Institut Royal Belge d’Aéronomie Spatiale (BISA).
Résumé:
Dans une large mesure, la composition chimique de la troposphère est régie par les interactions entre la terre et l'atmosphère. En raison de leur grande réactivité et de leur omniprésence, les composés organiques volatils (COV) influencent fortement le pouvoir oxydant de l’atmosphérique, la formation de l’ozone troposphérique et de particules en suspension. Ils réagissent rapidement avec les radicaux hydroxyles (OH), le principal détergent atmosphérique, qui joue un rôle central dans la chimie de l'atmosphère. L'isoprène (C5H8) est le composé organique volatil biogénique (COVB) le plus abondant émis par la végétation terrestre, principalement par les arbres. Outre les importantes émissions dans certaines régions extra-tropicales telles que le sud-est des États-Unis, la majeure partie des émissions de COVB provient des écosystèmes tropicaux terrestres, en raison de la présence de forêts équatoriales denses ainsi que de conditions climatiques favorables. Toutefois, ces régions tropicales figurent parmi les environnements les moins étudiés et les plus incertains en termes d’émissions et de processus chimiques. En particulier, les faibles concentrations d’oxydes d’azote (NOX = NO + NO2) qui y prévalent modulent fortement les voies d’oxydation des COV. Les émissions naturelles de NOX , issues des processus microbiens du sol et de la foudre, représentent une source importante en Afrique et en Amérique du Sud, mais leur quantification reste associée à de fortes incertitudes. L’étude des COVB nécessite une approche interdisciplinaire combinant identification, quantification et compréhension de leurs sources, comportement et impacts atmosphériques. En chimie atmosphérique, la caractérisation des flux d’émission, de leur variabilité spatio-temporelle et de leurs impacts représente un défi majeur qui requiert une intégration de données satellitaires globales, complétées par des mesures in situ et de télédétection au sol, ainsi que l’usage de modèles numériques avancés incorporant les représentations les plus récentes des processus physico-chimiques, y compris les réactions photochimiques pertinentes. En particulier, les observations satellitaires du formaldéhyde (HCHO), un intermédiaire clé de l’oxydation de l’isoprène et d’autres COV, permettent d’inférer des informations précieuses sur les émissions de COVB lorsqu’elles sont couplées à des modèles de chimie-transport atmosphérique reliant les flux d’émission aux concentrations mesurées. Les modèles inverses, intégrant des algorithmes d’optimisation, visent à affiner l’estimation des émissions en exploitant les contraintes issues des observations satellitaires.
Cette thèse porte sur l’évaluation par modèle des émissions de gaz traces naturels, avec un accent particulier sur les émissions d’isoprène et de NOX naturelles, en s’appuyant sur l’exploitation de nombreuses données satellitaires, notamment les distributions de la couverture terrestre, l’humidité du sol, les densités de colonne de formaldéhyde, NO2 et d’isoprène, ainsi que les profils verticaux de NO2.
Le travail présenté ici se décline en : (i) une étude de l’impact de la distribution et de l’évolution de la couverture terrestre sur les estimations des émissions globales d’isoprène, incluant l’identification des principaux facteurs d’incertitude dans leur évaluation ; (ii) une étude des effets de la paramétrisation du stress hydrique sur les flux d’émission d’isoprène, appuyée sur des mesures uniques de flux réalisées lors d’épisodes de sécheresse dans le centre des États-Unis, avec une analyse des facteurs d’incertitude ; (iii) l’estimation et l’évaluation des émissions d’isoprène et de NOX obtenues via des inversions à deux espèces, exploitant les concentrations satellitaires de HCHO et de NO2 au-dessus de l’Afrique et de l’Amérique du Sud.
Cette étude contribue au développement d’un inventaire global et à long terme des émissions d’isoprène selon une approche ascendante (en anglais, bottom-up) intégrant les distributions de la végétation observées par satellite, ainsi qu’à l’élaboration d’inventaires descendants (en anglais top-down) des émissions naturelles d’isoprène et de NOX sur l’Afrique. L’étude d’inversion sur l’Afrique et l’Amérique du Sud repose sur le modèle de chimie-transport (CTM) MAGRITTE et son module d’inversion, développés et adaptés aux inversions à deux espèces par l’équipe de modélisation troposphérique de l’Institut Royal Belge d’Aéronomie Spatiale (BISA).
Date(s)
Le 15 avril 2025
Lieu(x)
Salle Somville (S02.331 – bâtiment S, 2è étage, local 331) sur le campus du Solbosch de l'ULB, ainsi qu'en ligne via TEAMS
Documents à télécharger
- Opacka_Public Announcement.pdf PDF, 111 Ko