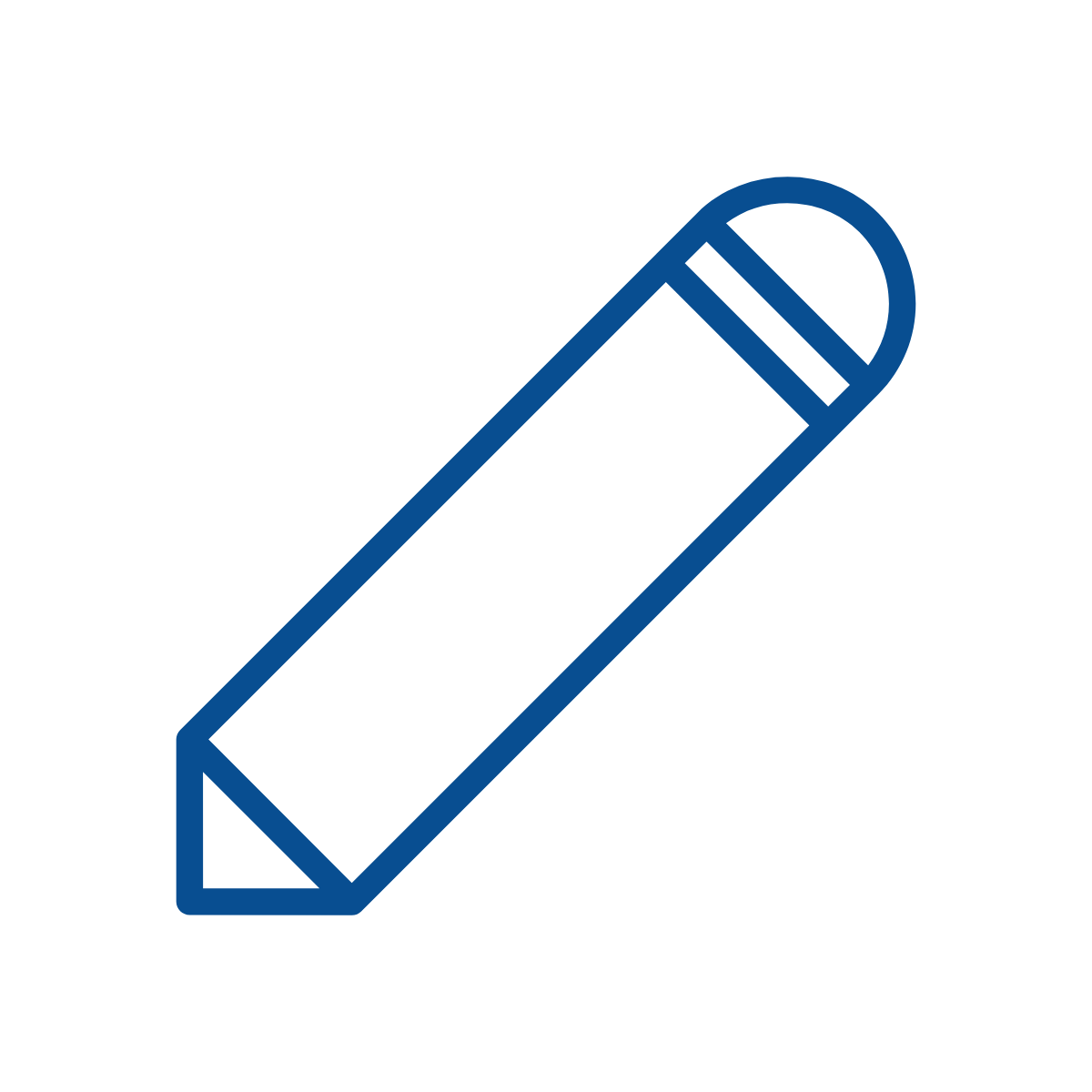-
Partager cette page
Histoire économique des arts
Titulaire(s) du cours
Anne-Sophie Radermecker (Coordonnateur)Crédits ECTS
5
Langue(s) d'enseignement
français
Contenu du cours
Le cours se présente comme une introduction à l’histoire économique des arts et a pour objectif de familiariser les étudiant.e.s à un pan de recherche en pleine expansion, à l’interface des humanités numériques, des art market studies, et de l’économie de l’art et de la culture. Par le biais d’analyses critiques d’articles scientifiques innovants et représentatifs de ce courant, les étudiant.e.s parviennent à identifier les apports des données et de la quantification pour la compréhension des mondes de l’art au sens large.
Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)
A l’issue du cours, les étudiant.e.s sont capables de :
- Avoir une bonne connaissance de la littéracie à l’interface de l’histoire des arts et de l’économie ;
- Identifier les principaux auteurs de référence en ces matières ;
- Identifier les principales questions ayant trait à l’histoire des arts qu’une approche quantitative/économique permet éclairer ;
- Questionner de manière pertinente une base de données en vue d’alimenter la connaissance en histoire de l’art ;
- Comprendre les méthodes quantitatives utilisées pour questionner les données ;
- Aborder de façon critique les outils méthodologiques utilisés et les limites des études de ce type.
Pré-requis et Co-requis
Connaissances et compétences pré-requises ou co-requises
Si la plupart des séances du cours seront dispensées en français, une maîtrise de l’anglais (lecture et orale) est indispensable. En effet, les articles analysés sont publiés, pour la plupart, dans des revues anglo-saxonnes et le cours sera jalonné d’interventions de spécialistes non francophones en ces matières. La dimension interactive du cours requiert une capacité des étudiants à interagir en anglais, avec l’aide de la titulaire si besoin.
Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages
Les séances alterneront entre intervention de la titulaire et intervention de spécialistes extérieurs, selon un format de séminaire.
La méthode d’enseignement se veut empirico-inductive, basée sur des articles représentatifs de l’histoire économique des arts. Concrètement, chaque séance démarrera par une discussion collective autour d’une problématique et d’un échantillon donné. L’objectif est d’amener les étudiant.e.s à questionner cet échantillon en lien avec la problématique, selon une approche intuitive et sur la base de leur connaissances préalables. La seconde partie consistera en une analyse plus détaillée d’un article scientifique, expliqué par la titulaire, avec une attention particulière portée aux questions posées, à la méthodologie et aux résultats. L’exercice pourra être répété à plusieurs reprises sur les deux heures de séance, en fonction du nombre d’articles examinés. Les étudiants seront invités à lire l’article dans le détail à domicile et à poser d’éventuelles questions lors de la séance suivante.
Le succès du cours dépendra très largement de la capacité des étudiant.e.s à prendre la parole, à interagir et à échanger de façon critique et bienveillante (sans quoi la titulaire du cours se garde le droit de mettre en place des dispositifs d’évaluation de participation).
Références, bibliographie et lectures recommandées
Bibliographie sélective
L’approche pédagogique du cours se voulant inductive, la liste des articles spécifiques discutés en auditoire sera fournie au fur et à mesure des séances.
Béatrice Joyeux Prunel (ed.) (2008). L’art et la mesure. Histoire de l’art et méthode quantitative. Paris, Editions Rue d’Ulm.
Brown, K. (2020) (ed.). The Routledge Companion to Digital Humanities and Art History. New York, Routledge.
Ginsburgh, V., & Mairesse, F. (2012). Dimensions of dialogue: Art history and the discourse of economics. In Art History and Visual Studies in Europe (pp. 167-184). Brill.
Radermecker, A. S., & Alvarez de Toledo, F. (2023). The History of Art Markets: Methodological Considerations from Art History and Cultural Economics. International Journal of Digital Art History. Available online: https://dahj. org/article/thehistory-of-art-markets (accessed on February 7, 2023).
Radermecker, A.-S., Anonymous Art at Auction. The Reception of Early Flemish Paintings in the Western Art Market (1946–2015). Boston/Leiden, Brill.
Seave-Greenwald, D. (2021). Paintings by Number. Data-driven histories of nineteenth-century art. Princeton University Press.
Van Hooland, S. et al. (2016). Introduction aux humanités numériques. Méthodes et Pratiques. DeBoeck.
Withaker, A. (2021). Economics of Visual Arts. Market Practice and Market Resistance. Cambridge University Press.
Special issue du European Review of Economic History (ed. Prof. Karol Borowiecki) – Economic history of the arts (2023)
Special issue du Journal of Cultural Economics (ed. Prof. David Galenson) – Economics of art history (2023)
Support(s) de cours
- Université virtuelle
Contribution au profil d'enseignement
Cette UE permet d’acquérir des savoirs théoriques transversaux en matière d’histoire économique des arts. Elle offre également un aperçu du système économique dans lesquels s’inscrivent les arts, selon une approche historique et contemporaine.
Autres renseignements
Informations complémentaires
Cours dispensé sous la forme de 6 blocs de 4h, environ un mercredi sur deux au 1er quadrimestre de l’année académique 2024-2025 (12h00-14h00 en présentiel, 18h00-20h00 en ligne). Un auditoire est toutefois réservé pour le créneau en soirée afin de permettre aux étudiant.e.s ayant cours en amont de bénéficier d’un lieu de travail. Voir Time Edit pour plus d’informations sur les locaux.
Contacts
Prof./Dr. Anne-Sophie V. Radermecker (Anne-Sophie.Radermecker@ulb.be)
Campus
Solbosch
Evaluation
Méthode(s) d'évaluation
- Travail personnel
Travail personnel
L’évaluation prendra la forme d’un travail écrit individuel, rédigé en français ou en anglais, à remettre pour le 20 décembre 2024 (à uploader sur l'UV pour 23:59 max). Tout travail remis au-delà de cette échéance ne sera pas évalué.
Consignes : format word .docx, time new roman, police 11, espace 1.15.
Le travail devra être conforme aux standards académiques attendus au niveau de Master (structure, langage, clarté, référencement, neutralité de ton, grammaire, orthographe, etc.), sans quoi celui-ci ne sera pas jugé recevable. L’usage d’IA (ChatGPT et autre) non référencé sera sanctionné, à l’instar de toute forme de plagiat.
Le travail se composera comme suit :
Partie 1. (10 pages de contenu max., bibliographie comprise, hors page de garde, table des matières)
- Identification d’une base de données/d’un échantillon de données au choix liées aux arts ;
- Contextualisation et présentation détaillée de la base de données + réflexion critique sur ses apports potentiels et limites ;
- Réflexion sur les questions que pose cette base de données/échantillon et dans quelle mesure ces questions peuvent apporter un éclairage intéressant pour l’histoire des arts (problématique, etc.) ;
- Réflexion sur le type d’analyses qui pourrait être conduit sur les données ;
- Réflexion sur les hypothèses et résultats envisagés.
Le travail devra être contextualisé scientifiquement avec l’apport d’une bibliographie. L’originalité de la base de données choisies et de l’approche sera particulièrement valorisée dans la note. Si l’étudiant souhaite reprendre une base de données/un échantillon vu en cours, l’exercice consistera à dépasser les analyses déjà menées sur cet échantillon.
Partie 2. Compte rendu critique d’un article scientifique à l’interface de l’histoire des arts et de l’économie (3-5 pages max).
- Choix d’un article scientifique portant sur l’histoire économique des arts (avec usage d’économétrie). Une liste d’articles sera proposée aux étudiant.e.s. Les étudiant.e.s désireux de choisir un article/chapitre de livre horsliste et non vu en cours pourront soumettre leur proposition à la titulaire qui la validera ou l’invalidera.
- Compte rendu critique de l’article avec :
-
- Résumé de la problématique ;
- Description de la méthodologie ;
- Exposition des principaux résultats ;
- Opinion critique sur l’article (des liens avec d’autres articles sont bienvenus)
Seconde session août: En cas de non remise du travail ou d'échec, l'étudiant.e sera invité.e à redéposer une version du travail lors de la session d'août.
Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)
Sur un total de 100 points, la note se structurera comme suit :
- Partie 1. (réflexion critique sur une base de données) = 70 points
- Partie 2. (compte rendu critique d’un article scientifique) = 30 points
Langue(s) d'évaluation
- français