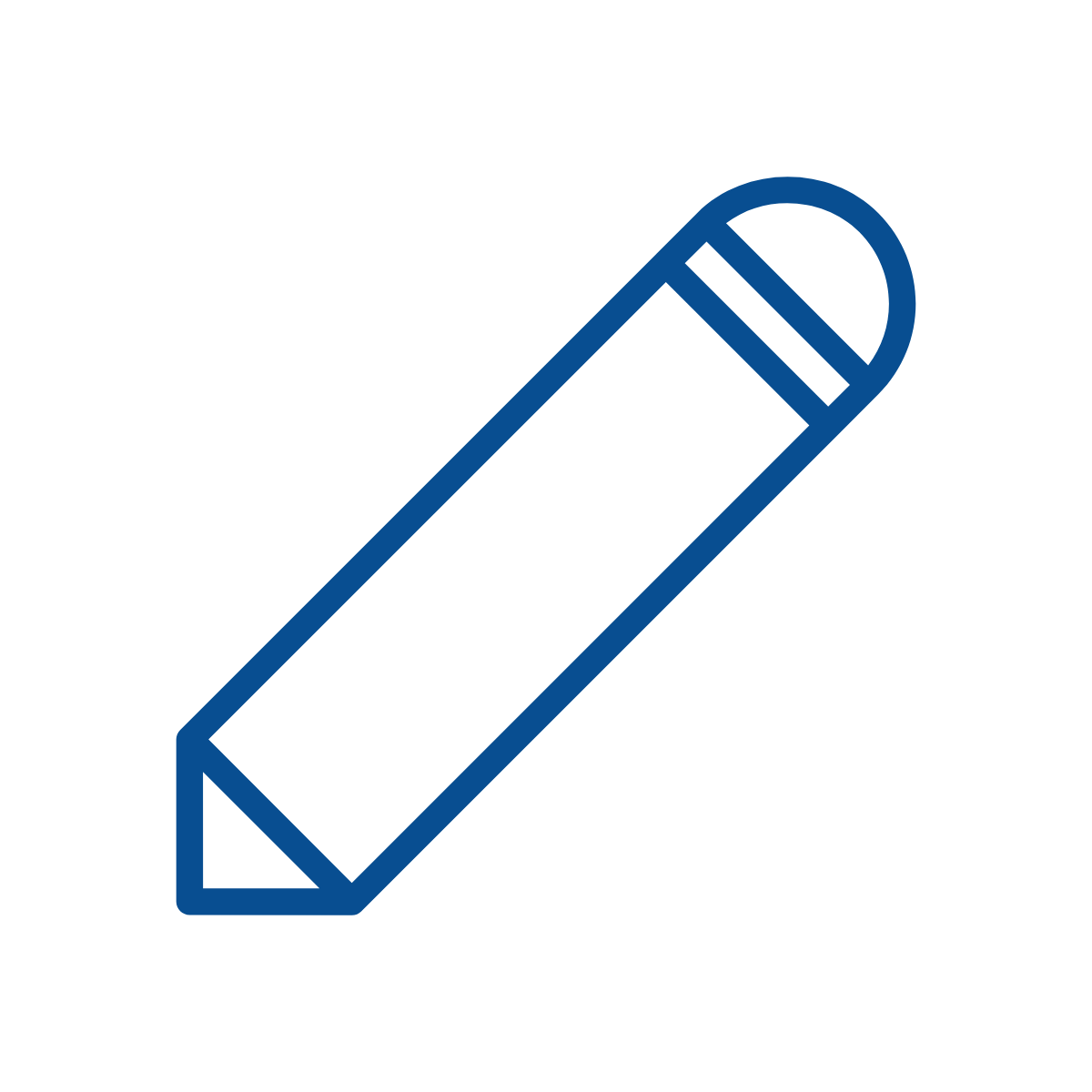-
Partager cette page
Projet d'architecture 4.17 : LAP - Lieux Architecture Paysage
Crédits ECTS
20
Langue(s) d'enseignement
français
Contenu du cours
Le regard sur le territoire s’enrichit du renforcement et du déploiement de la discipline de l’architecture du Paysage, de ses expressions et de ses préoccupations, en pleine effervescence dans l’accélération du changement climatique.
L’atelier propose d’explorer par le projet la relation entre les disciplines de l’architecture et du paysage, leur perméabilité réciproque, d’identifier et d’interroger les éventuels malentendus voire les conflits engendrés, de comprendre les superpositions et les hiérarchies, et de rechercher les confluences et relations symbiotiques générées par les regards croisés des deux points de vue.
Les approches spatiales entre projet d’Architecture et projet de Paysage se reconnaissent à l’évidence dans la culture de l’espace, la manipulation des échelles, les outils de conception et de représentation, et le processus du projet, entre autres. Elles se distinguent cependant dans la préoccupation fondamentale du vivant qui opère sur les transformations du paysage dans le cas du projet de Paysage, et dans la finalité édificatrice dans le cas du projet d’Architecture.
L’ambition est d’interroger la rencontre entre architecture et paysage dans l’exploration de lieux inscrits dans des figures territoriales majeures, à savoir des paysages transformés par les activités humaines, aux points de rencontre entre leur origine, les résurgences d’écritures passées et les enjeux contemporains[1].
Rencontres, complémentarités, collisions, dissonances, points de convergences, de fusion, angles morts etc. Il s’agit d’identifier, de prendre la mesure et de révéler de manière critique les relations complexes entre paysages et architectures et s’en nourrir[2]. L’atelier questionne ici les bords et les nœuds, ceux qui définissent avec plus ou moins de netteté les paysages ainsi que les contours disciplinaires entre architectures et paysages, comme autant de limites ou d’interfaces, physiques, disciplinaires ou théoriques.
Il s’agit d’être dans le paysage, perçu et vécu, comme (lieu d’) habitat et comme lieu parcouru. Pour intensifier le regard lors des recherches, une série de marches exploratives nourrissent de manière empirique le travail de projet. L’attention se focalisera sur le « sol », qui constitue pour l’atelier une préoccupation majeure, un leitmotiv méthodologique, à partir duquel peuvent se déplier les autres dimensions. En plus des thématiques liées au vivant, à la mémoire, à la transformation du sol, etc., l’ambition est également d’aborder les enjeux liés à son (in)détermination et ses usages.
Cette étude sera appréhendée horizontalement (le sol) et verticalement (sous-sol/hors-sol), à la recherche des couches visibles et invisibles du paysage, en coupant dans la matière. Des matériaux constitutifs du paysage seront collectés, fragments choisis et identifiés à partir desquels « les paysages du paysage », seront élaborés, développés et (re)construits, qui révéleront les processus qui ont amené à l’existence d’un territoire, et les temporalités qui y sont associées.
Le projet sera naturellement utilisé comme outil de connaissance, et de négociation dans et avec le paysage, en considérant les paradigmes actuels qu’induisent les changements climatiques. Il s’agit d’assumer d’un côté le projet pour sa force de proposition et d’un autre, son caractère édifié, embarquant une série de questions à la fois théoriques, pratiques et techniques. L’atelier propose une entrée en matière dans le projet par le détail, à la fois dans ses dimensions techniques et sensibles, mais aussi économiques, politique et paysagère. L’ambition est de proposer par le détail une spéculation sur la question des procédés et des processus (de conception, de transformation, d’édification, d’interaction, …) et de la prolonger comme un outil de réflexion sur les ressources. En commençant par l’échelle du détail, la relation avec le projet s’intimise, et permet d’élucider des questions liées à la consistance de l’architecture.
[1] Cf. Le territoire comme palimpseste, A. Corboz, 1983
[2] Cf. inspiré librement de la méthode de la géographie des controverses de B. Latour (http://www.bruno-latour.fr/node/31.html)
Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)
Le « projet » constitue intrinsèquement le moteur d’un atelier. LAPs entend conserver cette dynamique et souhaite mettre les objectifs et l’attention à différents niveaux :
Enjeux et projet : Le projet constitue l’espace où s’explore et se définit la manière dont les enjeux se manifestent. On y recherche et évalue de manière critique la cohérence entre les objectifs visés, les contraintes inhérentes au projet et la proposition de formes, d’espaces, d’usages, etc. Le projet reste par ailleurs un outil de « résolution ». Il permet, en parallèle à l’explicitation des enjeux, le choix et la mise au point précise des éléments spatiaux et formels .
Attitude critique & réflexive : A partir d’une situation complexe, LAPs encourage les étudiants à porter un regard autonome critique et réflexif sur leur travail durant l’année. La pertinence et la cohérence de l’ensemble du processus, du travail et des propositions doivent être centrales dans la pratique du projet. En miroir, l’atelier adopte tout au long de l’année un regard réflexif sur son propre fonctionnement et se donne la possibilité d’en adapter les modalités.
Entre production collective et recherches personnelles : LAPs a pour objectif de permettre aux étudiants d’évoluer dans un contexte à géométrie variable. Le travail sera effectué de manière personnelle, mais aussi en groupe de petite taille, de taille moyenne, et rassemblé dans un objet collectif. Les différentes configurations pourraient être amenées à évoluer en fonction de l’avancement. Il s’agit de renforcer la capacité à nourrir son propre travail, le groupe, à organiser et mutualiser la production.
Interdisciplinarité : Le travail interdisciplinaire fait partie de la méthode mais aussi des objectifs à atteindre. Cette ambition sera concrétisée par la convocation de sources et méthodes spécifiques aux disciplines de l’architecture et du paysage. LAPs encourage les échanges sur les approches conceptuelles et les outils employés, sur les langages communs et distincts. L’intention de l’atelier est de cultiver l’ouverture à d’autres disciplines, et de pouvoir solliciter savoirs, méthodes, interlocuteurs … d’autres registres et domaines.
Traverser les échelles : L’atelier propose d’aborder le projet par différentes échelles, celle de la société, du grand paysage, celle du détail, voire plus loin, ainsi que les échelles intermédiaires. L’objectif est de développer l’approche multiscalaire dans la compréhension des constructions humaines, en interdépendances avec des milieux complexes.
Pré-requis et Co-requis
Cours ayant celui-ci comme pré-requis
Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages
Une pédagogie « inversée » : La pédagogie s’étend sur l’année, et prend en compte la présence des étudiants paysagistes au second semestre. La pratique classique qui appréhende la fabrication du projet en partant de la grande échelle est ici inversée, en faveur d’une approche par le détail d’architecture et le fragment du paysage.
Au 1er quadrimestre, l’atelier entame le projet par des éléments appréhendables. D’un côté, le regard est directement posé sur le détail du projet d’architecture. Il s’agit de rentrer dans « la matière de l’architecture » par un élément précis, qui enclenche une réflexion plus large. D’un autre côté, un fragment du paysage sert de prétexte pour reconstruire « les paysages du paysage ». Dans les deux cas de figure, ce travail s’articule avec la réflexion théorique, à développer sur base du détail et du fragment. En parallèle, il s’agit d’identifier les enjeux ciblés et les acteurs liés au contexte, en s’appuyant sur les documents existants et la pratique des lieux par des marches et enquêtes, in situ. Ce travail permet d’appuyer les scénarios et esquisses de projets développés lors du semestre, qui servent de base pour la suite des projets au second semestre.
Au 2nd quadrimestre, l’atelier demande aux étudiants de poursuivre le travail sur les dispositifs spatialisés. Révélatrice et/ou perturbatrice des paysages explorés, la nature des projets est précisée par les étudiants dans la prolongation des recherches et projets du premier quadrimestre. Il s’agit d’expérimenter une architecture dans et du paysage, en collaboration avec les étudiants en architecture du paysage.
Les paysages du paysage : lors de la première visite de site, chaque étudiant collecte un « fragment de paysage », manipulable, élément physique déclencheur d’investigations territoriales, qui renvoient à d’autres paysages. Par groupe d’affinité de fragments, les étudiants questionnent la matière récoltée et retracent le parcours de ces échantillons, dans l’espace et le temps, cherchent à remonter à leur origine et à traduire graphiquement la nature et l’évolution des paysages qui y sont rattachés.
La matière de l’architecture : dès l’entame du travail, chaque étudiant choisit « un détail d’architecture », existant ou non. L’objectif est de construire une réflexion précise sur la matière et les ressources, de faire des choix en termes de matérialités et de procédés en cours de quadrimestre, et de développer des connaissances précises sur ces choix, ainsi que sur les formes, espaces, usages, … qui y sont liés.
Être « dans le paysage » : Afin de rencontrer le site dans ses singularités, l’atelier LAPs invite les étudiants à adopter une approche « à même le paysage », à appréhender le territoire dans sa réalité physique et humaine[1]. A ce titre, une série de voyages, visites, rencontres in situ sont planifiés dans le cours de l’année. Cette méthodologie par contact, tâtonnement et expérimentation a aussi pour objectif de dégager des enjeux et des possibilités (nécessités) de projet et de les situer.
Représentation/production : L’atelier entend se focaliser sur la représentation en croisant les moyens utilisés par chacune des disciplines, et en se concentrant sur la capacité révélatrice de chaque document. Par exemple : le transect collectif, le glossaire, le bloc diagramme, croquis et carnet in situ, la coupe, le détail à grande échelle, le Leporello. Ces outils auront pour vocation d’explorer, avec des modes de représentations graphiques divers, les relations plus ou moins étroites entre l’architecture et le monde de la terre et du vivant.
[1] Comme le recommande le paysagiste Bernard Lassus dans Mouvance, « …c’est aussi découvrir dans l’usage même des lieux ce qui a été occulté par l’usure du quotidien, et est en train de disparaître. Il nous faut tout autant amener au visible les traces de nouvelles pratiques, non encore identifiées ; ainsi porter le non-visible au visible puis à l’évident. »
Références, bibliographie et lectures recommandées
Les informations seront communiquées via les plateformes utilisées par l’atelier et lors des activités.
Autres renseignements
Informations complémentaires
TERRAIN D’EXPLORATION
Le fonds de territoires de travail proposé pour les recherches des années à venir est le bassin minier européen, s’étendant du Royaume-Uni à la Ruhr, en passant par la France, la Belgique et le Luxembourg. Déterminés par la nature de leur sous-sol, ces territoires d'origine essentiellement rurale ont connu dans leur histoire récente une double transformation avec dans un premier temps l’avènement de l’industrie minière et ses corollaires – urbanisation, infrastructures, … – et dans un second temps le déclin brutal de celle-ci à l’échelle régionale.
C’est donc la géologie qui détermine l’emprise de ce territoire, plus précisément cette année le filon houiller du nord de la France, étendu sur près de 100km ponctués de 78 terrils, qui en constituent la trace la plus emblématique. Ces paysages anthropiques ont été et sont marqués par des activités à vocation quasi exclusivement productive et extractive. Après la chute de l’industrie minière dans les années 1970-90, et la dépression qui s’en suivit, les réflexions sur la reconversion de ces territoires se sont développées, devant répondre à des enjeux patrimoniaux, écologiques, économiques et sociaux majeurs. Cette nécessaire mutation s’appuie entre autres sur le classement au Patrimoine mondial de l’Unesco du « Bassin Minier Nord-Pas-de-Calais ».
Il s’agit d’un territoire d’infrastructures, de villes moyennes étalées, dédiées majoritairement à la mine, montrant des figures urbaines et architecturales récurrentes, accueillant plus d’1 million d’habitants. La vaste trame technique et le tissu humain qui l’incarne reposent sur un réseau hydrologique complexe, à la rencontre entre les plateaux de l’Artois et les plaines des Flandres ; paysage « banal » d’horizons et de rivières canalisées dans une vaste matrice agricole, contrastant avec les vestiges « monumentaux » de l’industrie minière qui ont déplacé les lignes topographiques hors et sous-sol.
ORGANISATION DE L'ATELIER
Your Future Practice[1] : LAPs offre la possibilité aux MA2 de “considérer le Q10 comme le premier projet de leur parcours professionnel, marquant la fin d’un parcours universitaire, d’essais de calibrage, de profilages, de positionnements et des préfigurations de leur futur [...] en les confrontant une dernière fois à une équipe enseignante”.
TFE : La pédagogie entend également profiter des thématiques abordées par les étudiants de MA2 pour leur TFE. Une série de séminaires ponctuels seront organisés dans l’atelier afin de pouvoir échanger sur leurs sujets et explorer les liens possibles avec le travail de l’atelier.
NOTA BENE :
1. Les projets pourront être individuels ou en groupes. L’atelier attend de l’étudiant un engagement déterminé autant dans les travaux de groupes que dans son travail individuel. Chaque semaine, la production doit pouvoir faire l’objet d’échanges avec l’ensemble de l’atelier. Les lundis après-midi, LAPs propose de convertir l’atelier en « parlement », au sein duquel seront présentés et discutés les sujets et de prendre des décisions le cas échéant.2. La présence à l’atelier & ses activités est obligatoire, comme la présence aux voyages organisés (à ce stade, un voyage d’une journée le 20/09 et une semaine in situ du 28 au 01/11 sont prévus. Ces Informations sont indicatives et sujettes à évolution durant le cours de l’année).
3. Des collaborations spécifiques sont prévues avec l’ENSAPL de Lille, des enseignants de la faculté, dont Virginie Pigeon, Pauline Levebvre, Typhaine Abenia, Sophie Hubaut, entre autres, ainsi que des intervenants extérieurs, parmi lesquels Philippe Rizzotti. La liste exacte et le planning dédié sera communiqué en atelier.
4. Un groupe Teams spécifique sera créé sur la plateforme de l’ULB et constituera le lieu centralisé et obligatoire d’échange des informations.
[1] En se basant sur l’expérience développée par Patrice Neirinck dans l’atelier APA (Art, Paysage, Architecture), elle-même empruntée à la pédagogie de l’atelier de Marc Godts à Sint Lukas Brussel.
Contacts
Fabien Dautrebande – Ir Architecte, Chargé de cours : Fabien.Dautrebande@ulb.be
Julie Martineau – Ir Paysagiste, Chargée de cours : Julie.Martineau@ulb.be
Campus
Autre campus, Hors campus ULB, Flagey
Evaluation
Méthode(s) d'évaluation
- Projet
Projet
CRITERES GENERAUX ET SPECIFIQUES A L’ATELIER
- Compréhension générale de la demande
- Capacité à croiser différentes disciplines, registres et techniques, et pouvoir en faire l’usage et la synthèse
- Capacité à mobiliser des ressources bibliographiques et associées
- Capacité à dégager un/des questionnement(s) / préoccupations en lien avec les thématiques générales, de manière fondamentale ou d’actualité, et à pouvoir l’exprimer.
- Capacité à développer des préoccupations théoriques d’architecture claires et précises
- Capacité à se saisir et à travailler avec les enjeux du paysage et à les articuler aux questions d'architecture
- Capacité à prendre position de manière claire, que ce soit au niveau des enjeux que du projet
- Capacité à « fabriquer » un projet avec des préoccupations architecturales claires, résolu, appuyé et articulé avec les questionnements et préoccupations explicités au préalable, dont le paysage
- Capacité à « communiquer » le projet à l’aide de moyens d’expressions pertinents et exploratoire
- Capacité à définir les usages & interlocuteurs liés au projet, son implantation, ses nécessités et besoins et transposer l’ensemble en un concept spatialisé
- Attitude générale et implication/engagement personnelle face à la demande
- La présence et la proactivité aux séances d’atelier, aux visites et aux voyages.
- Qualité et maîtrise de la communication orale et graphique et de présentation, entre autres à travers la construction d’un discours et d’un argument (vocabulaire, références, rhétorique, etc.)
CRITERES SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES POUR LES BA3
- Maîtriser le rapport entre le corps et l’espace à travers le dimensionnement spatial
- Maîtriser les éléments de la composition architecturale
- Capacité à communiquer en atteignant une qualité sensible de composition spatiale.
- Usages & interlocuteurs : Comprendre et introduire ces notions dans le projet
- Échelles : Comprendre la logique des différentes échelles qui forgent la synthèse des recherches et du projet, du détail/fragment à l’échelle de la société
- Matière, ressources, procédés, processus : Développer un propos cohérent sur la matérialité et les logiques constructives, ainsi que sur les questions liées
CRITERES SPECIFIQUES POUR LES MASTER
- Tous les critères de BA3
- Développer une attitude réflexive enrichissant les théories et les pratiques de l’architecture
- Construire, en tant qu’architecte, un engagement citoyen et une pratique éthique et responsable, au sein de l’atelier et lors du travail
- Pouvoir interagir avec l’ensemble des interlocuteurs concernés
- Pour les étudiants ayant choisi "Your Future Practice" : la capacité à développer une réflexion complète d’un processus de projet en grande autonomie, depuis l’identification des enjeux jusqu’à la réponse spatialisée et à prendre attitude à tous niveaux (projet/représentation/...)
Voir également le Profil d'enseignement du master en architecture à l'ULB (conseil facultaire du 20 janvier 2015) pour plus de précisions.
Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)
DEUX MODES D’ÉVALUATION SONT PRÉVUS :
1. Une évaluation formative continue portant sur le travail fourni par l’étudiant·e (avec remises intermédiaires, aux dates convenues, de l’état d’avancement des recherches, et projets de groupe et individuels) et sa participation active et engagée durant les ateliers. Ces évaluations formatives seront communiquées à l’étudiant·e tout au long de l’année, à l’issue des moments-clé, avec une synthèse de celles-ci à l’issue du premier quadrimestre. Elles servent à renseigner l’étudiant.e sur sa progression par rapport aux exigences, mais n’interviennent pas dans la construction de la note « officielle » de l’UE « Projet ».
2. Des évaluations certificatives à l’issue de chacun des quadrimestres. Ces notes permettent de prouver que l'étudiant.e a acquis les compétences visées par l’enseignement.
CONSTRUCTION DE LA NOTE
La pondération de la note de l’UE se base sur les évaluations certificatives, selon la pondération suivante :
- Évaluation certificative du Q1: 25 %
- Évaluation certificative du Q2 : 75 %, répartis de la manière suivante :
Travail durant le Q2 en atelier : 20 %
Workshop “SIP” : 5 % **
Jury final : 50 %
La note de l’UE Projet sera la moyenne arithmétique pondérée de ces notes certificatives.
** NB : pour les MA2, les 5% du « Workshop SIP » auquel ils ne participent pas sont transféré dans la note « Travail durant le Q2 en atelier ».
Langue(s) d'évaluation
- français
- anglais