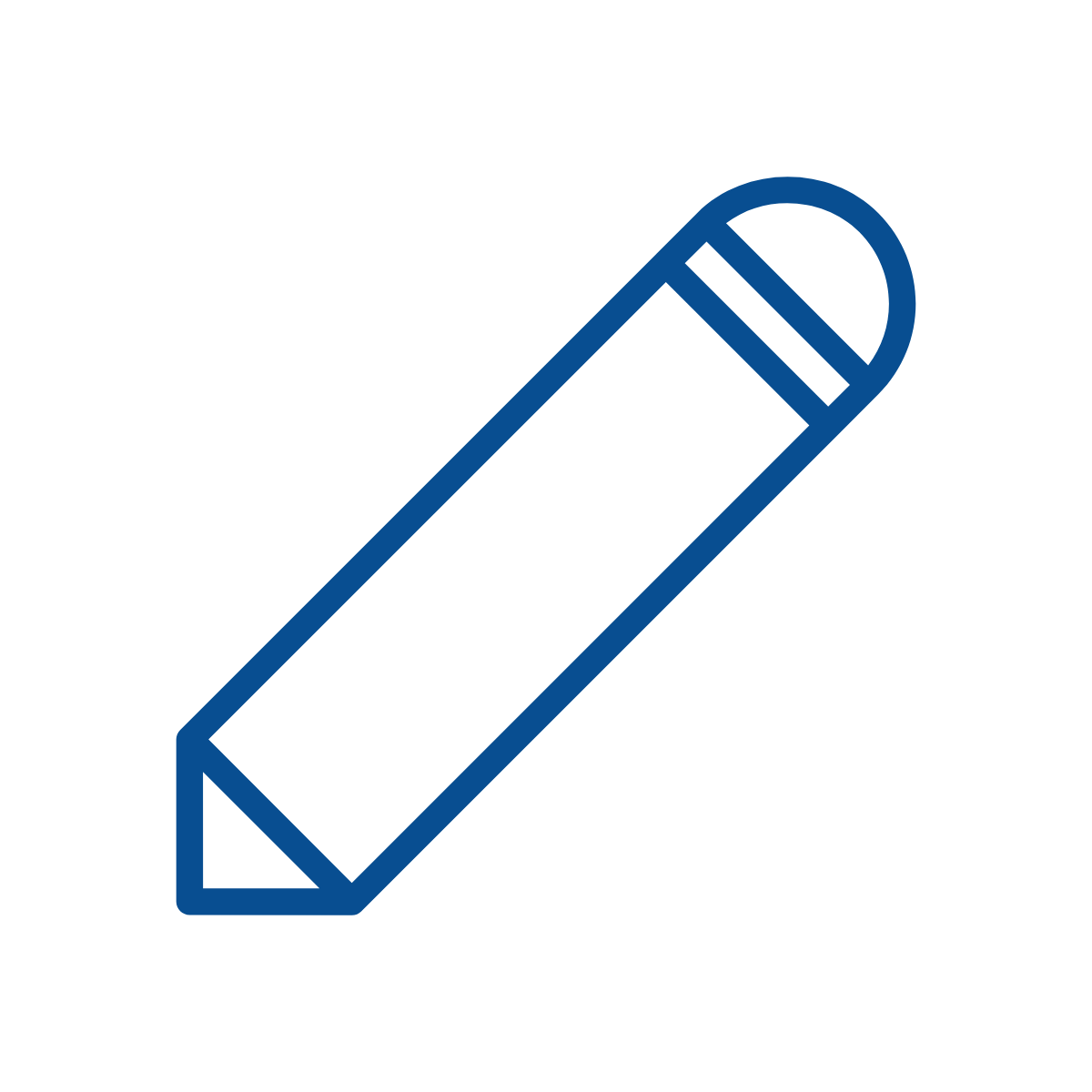-
Partager cette page
AC2 - Architecture et Cinéma (module 2)
Titulaire(s) du cours
Thomas VILQUIN (Coordonnateur) et Cristina ENESCUCrédits ECTS
10
Langue(s) d'enseignement
français
Contenu du cours
1. Approche thématique
Ce quadrimestre, nous avons choisi de travailler sur la thématique suivante :
Du Marien au Bempt
Depuis son rachat en 2018 par des investisseurs anglais et son ascension en 1e division, le club de football de l’Union Saint-Gilloise est trop à l'étroit dans son stade historique, le Joseph Marien à Forest. Il a dès lors l'ambition de construire un nouveau stade, qui serait bâti sur le site du Bempt, toujours à Forest. Toutefois, ce projet suscite de nombreuses interrogations quant à ses conséquences et ses impacts, divisant jusqu'au niveau politique. Plusieurs parties prenantes (dont la Commune de Forest elle-même) réclament plus d'informations, à rebours de la monopolisation de la scène médiatique par les voix les plus puissantes, afin de pouvoir mener un débat public et éclairé.
À cet effet, la Boutique des Sciences (BdS) de l’ULB a initié en 2023 plusieurs travaux étudiants visant à explorer ces enjeux et angles morts : valeur biologique de la “friche” du Bempt, empreinte carbone de la construction et de l’usage d’un nouveau stade, impacts sur les finances communales, contraintes sur les activités actuelles dans le parc du Bempt et sur les terrains de sport, etc. Toutefois, il manque encore une mise en récit plus générale de ce projet, qui permette de raconter les différents enjeux à travers la voix des personnes concernées : riverains de la friche et du stade actuel, supporters, membres des administrations et représentants politiques communaux et régionaux, cafetiers, etc. C'est dans cet esprit que vont être développés une série de courts-métrages, pour évoquer ces différentes histoires de stade (existant ou à venir)
En fin de quadrimestre, une projection et un débat, organisés en collaboration avec la BdS et d’autres acteurs, seront l’opportunité d'intégrer dans la réflexion publique les nouveaux éléments ainsi récoltés.
2. Collaborations
Pour construire les films et les travaux réflexifs, nous mettons en place des collaborations avec des acteurs qui esquissent aujourd’hui les grandes lignes de développement de la ville de Bruxelles, comme des organismes publics et privés, des chercheurs et architectes, des associations, des cinéastes, des professeurs, des acteurs publics et culturels ou encore des artistes.
Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)
1. Développer son propre langage et une construction mentale architecturale en expérimentant le cinéma et la vidéo comme médias d’observation, d’analyse du réel et de création architecturale et urbanistique, intellectuelle et pratique, audiovisuelle et mentale.
2. Intégrer des connaissances et techniques filmiques et en faire un usage critique et pratique ou encore de redécouverte du réel et de sa place en tant qu’à la fois créateur et acteur du monde.
3. Acquérir des compétences supplémentaires en appréhension, construction, représentation et communication spatiale.
4. Jongler avec les deux points de vue scientifique et expérimental et être en mesure de communiquer le résultat de ses recherches à travers des médiums différents qui se complètent et se renforcent réciproquement.
5. Comprendre les logiques du métier de cinéaste, dans lequel des enjeux spatiaux, perceptifs et architecturaux sont présents, et pouvoir y mobiliser, en s’appropriant les outils et les méthodologies propres à cette discipline, les compétences acquises durant la formation en architecture.
Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages
Il s’agit de :
‑ cours théoriques et pratiques participatifs incluant des séminaires, des études de cas et des masterclasses ;
‑ participation active à la conception et au montage d’une installation collective, organisation de tables rondes, participation à des séances de cinéma et à des journées de recherche ;
‑ travaux personnels seuls ou en équipes de maximum trois étudiants : analyse de films, réalisation de notes d’intention, structures filmiques et story-boards ;
‑ réalisation d'un court-métrage ;
‑ organisation d'une projection publique ;
‑ rencontres avec des professionnels du monde du cinéma (acteurs culturels, cinéastes).
Le suivi des travaux personnels est assuré sous forme de séminaires.
Références, bibliographie et lectures recommandées
Les références bibliographiques et audiovisuelles seront données au fur et à mesure de l’avancement du cours. Seront proposées une série d’actions et de sorties culturelles essentielles pour rentrer dans le monde de l’audiovisuel et se former une culture cinématographique ; elles sont pour certaines obligatoires (cf. calendrier communiqué aux étudiants). De plus, il est fortement recommandé de prendre part à d’autres projections, rencontres, événements repérés de sa propre initiative.
Dans leur travail, les participant-e-s au cours adopteront une attitude active, éveillée, une présence bienveillante et participative. Ils et elles seront ainsi amené-e-s à déterminer de manière autonome les références et les sources complémentaires et spécifiques à leurs travaux d’investigation du réel, de recherche élargie et de création filmique.
Support(s) de cours
- Syllabus
- Université virtuelle
Contribution au profil d'enseignement
1- Concevoir un projet d’architecture de manière innovante utilisant des outils issus d’un autres domaine que l’architecture
Instruire une question architecturale ou urbaine. S'approprier une question thématique donnée collectivement et la traduire en des termes d’observation du réel architectural, urbain, paysager, environnemental, en vue de faire émerger, au moyen d’une démarche itérative, plusieurs hypothèses de travail, mettant en relation nombreux paramètres de ce qui constitue son terrain d’investigation. Expérimenter des territoires d’intervention potentiels pour les futurs architectes à l’aide d’outils et des méthodes cinématographiques ouvre le champ des possibles tant pour les manières de rencontrer le réel, de l’observer et de le rendre intelligible, que pour les manières de construire et imaginer des variations du réel observé. Techniquement, formellement, socialement, les outils du cinéma et ceux de l’architecture se complètent.
2- Développer une attitude réflexive enrichissant les théories et les pratiques de l’architecture à travers le médium cinématographique
Maîtriser un ensemble de bases théoriques et méthodologiques des disciplines associées à l’architecture : sciences humaines et sociales, sciences et techniques, art et culture, en vue de s’en emparer avec une maîtrise innovatrice pour enrichir la discipline architecturale.
Intégrer ces ressources indispensables, augmenter ses capacités d’en faire usage, avec plus de maîtrise, de connaissance et de réflexivité et pouvoir les saisir comme des opportunités d’ouverture de pans peu explorés du métier d’architecte / créateur de mondes. Fabriquer et transmettre une expertise spatiale en usant des compétences acquises dans les disciplines "autres" qui apportent des nouvelles compétences dans les champs de l’observation, de l’analyse, de l’observation et l’intégration des données, leur structuration et leur communication. En développer un usage réflexif de manière à transformer les instruments en véritables ressources de créativité. Problématiser en termes scientifiques des thématiques et questions de recherche et être en mesure de les communiquer.
3- Construire, en tant qu’architecte, un engagement citoyen et une pratique éthique et responsable
Envisager l’architecture comme discipline culturelle en perpétuel renouvellement, en relations constantes avec les évolutions des pratiques artistiques et des expérimentations sociales. Identifier, comprendre et déconstruire les évidences, les opinions et lieux communs en adoptant une posture ouverte et dynamique à l’égard de l’architecture dans ses multiples hypostases et les implications qu’elle suscite. Saisir les enjeux sociaux, politiques, éthiques des projets architecturaux et développer une attitude responsable à leur égard. Poser des choix engagés et autonomes, en synergie avec l’environnement. S’enrichir, s’ouvrir à la diversité des conditions des pratiques professionnelles, voire à leur réinvention. Observer les logiques des diverses disciplines dans lesquelles des enjeux spatiaux et architecturaux sont présents pour enrichir ses compétences et investir sa créativité en arrivant à diluer les frontières, grâce à cette formation, entre le métier d’architecte conçu étroitement dans le fait de construire des bâtiments et les multiples autres possibilités d’engagement avec la réalité.
4- Interagir avec l’ensemble des acteurs engagés dans les questions d’espace et d’architecture
Stimuler l'expérimentation et la créativité pour trouver des réponses ad hoc aux enjeux singuliers ou pluriels, construire et dynamiser sa vision du monde, fédérer les énergies de toute une équipe et susciter la cohérence des implications dans une même construction à multiples entrées et variables. Communiquer, de façon claire et structurée, à des publics avertis ou non, des informations, des réflexions, des idées autour de questions architecturales, anthropologiques, sociales, environnementales, philosophiques et de leurs résolutions spatio-temporelles, en intégrant un langage architectural augmenté d’une pensée et une écriture cinématographiques.
Autres renseignements
Contacts
‑ Thomas Vilquin (écriture filmique) ;
‑ Coline GRANDO (documentariste belge) ;
‑ Mélanie Ganino (architecte, artiste transdisciplinaire).
Les coordonnateurs et enseignants sont joignables par e-mail et via Teams. * Pour Coline Grando et Mélanie Ganino, c'est en attente de l'attribution de leur adresse mail ULB. *
La communication à destination des étudiants se fera par e-mail et via l'UV du cours (notamment pour la mise à disposition de documents).
Campus
Flagey
Evaluation
Méthode(s) d'évaluation
- Travail personnel
- Portfolio
- Travail de groupe
Travail personnel
Portfolio
Travail de groupe
Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)
Types d'évaluation :
1) L’évaluation continue consiste en plusieurs phases :
1° la participation et implication actives aux cours et aux événements culturels et citoyens auxquels le cours s’est engagé à participer ;
2° réaliser les missions hebdomadaires qui sont à remplir ;
3° apports significatifs aux cours, présentations, informations, travaux croisés, initiatives ;
4° qualité des éléments et des présentations aux remises intermédiaires ;
5° des rencontres avec des cinéastes et des invités publics et culturels sont organisées dans le cadre du cours. La participation aux séances de cours et aux séances indiquées est vivement conseillée et appréciée.
2) Productions individuelles
1° Pour faire des films, il faut voir des films et se constituer une culture cinématographique ; un carnet de bord rendra compte de ce travail soutenu. Dans le même esprit, des participations à des projections, à des conférences, événements liés à la thématique et au cours seront indiquées, il sera très apprécié que les étudiants y assistent et démarchent également de leur côté pour se former une culture, participer aux débats. Ces expériences pourront également être consignées dans le carnet de bord, accompagnées des réflexions qui s'en sont suivi à propos de la création du court-métrage.
2° Un travail écrit individuel portera sur l'analyse d'un court-métrage expérimental, en vue de l'utiliser pour la production de son propre projet filmique ; ce travail évaluera aussi la capacité d’utiliser les ressources proposées par la bibliothèque/médiathèque pour répondre aux questions et construire un propos.
3) Production de groupe
Production d'un court-métrage de maximum 10 minutes et de son dossier de recherche présentant le processus de réalisation. Présentation en pré-jury et jury. Installation accompagnant la projection publique.
La cote globale sera construite de la manière suivante :
30 % évaluation continue (remises hebdomadaires) ;
20 % productions individuelles (présence et participation aux cours, travail d'analyse de court-métrage et carnet de bord) ;
50 % production finale (court-métrage, dossier et installation).
En cas de seconde session, il s'agit de de remettre une nouvelle version du film (a priori sur base des retours qui avaient été faits lors du jury de juin), accompagné de son dossier révisé. Une différence avec juin sera que cette remise d'août ne sera pas cotée par un jury, mais uniquement par l'équipe enseignante.
Langue(s) d'évaluation
- français
- anglais